Burn-out et congé longue maladie fonctionnaire
Le burn-out — ou syndrome d’épuisement professionnel — est reconnu comme l’une des principales causes de souffrance psychique au travail, touchant tous les secteurs, y compris la fonction publique. L’impact sur la santé du fonctionnaire, sur la qualité du service public et sur la gestion des ressources humaines est considérable. Face à ce phénomène, le recours au congé longue maladie (CLM) s’impose souvent comme une mesure de protection et de rétablissement.
Ce texte propose une exploration approfondie de ce sujet, en s’intéressant aux causes, aux procédures légales, aux droits du fonctionnaire, au rôle de l’administration, et aux leviers de prévention.
1. Définition et spécificités du burn-out
1.1 Définition médicale
Le burn-out est défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un « syndrome résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès ».
Il se manifeste par trois dimensions :
- L’épuisement émotionnel et physique,
- La dépersonnalisation (cynisme et détachement vis-à-vis du travail),
- La diminution de l’accomplissement personnel au travail.
1.2 Une pathologie liée au contexte professionnel
Le burn-out n’est pas une maladie mentale à proprement parler dans les classifications médicales, mais un facteur aggravant de troubles psychiques tels que la dépression ou les troubles anxieux.
Dans la fonction publique, des facteurs spécifiques amplifient le risque :
- Charge de travail croissante,
- Manque de moyens,
- Conflits de valeurs,
- Difficulté à concilier mission de service public et contraintes budgétaires.
2. La reconnaissance du burn-out chez les fonctionnaires
2.1 Une reconnaissance indirecte
Contrairement à d’autres pathologies, le burn-out ne bénéficie pas d’une reconnaissance explicite comme maladie professionnelle au sens du Code de la sécurité sociale. Toutefois, ses conséquences peuvent être reconnues sous la qualification de trouble psychique.
2.2 Maladie professionnelle ou accident de service
Pour un fonctionnaire, un trouble psychique peut être reconnu :
- Soit comme un accident de service (événement soudain et daté),
- Soit comme une maladie professionnelle (pathologie inscrite sur un tableau ou reconnue après expertise).
Dans la pratique, le burn-out est rarement reconnu d’emblée comme accident de service. La preuve du lien direct avec le travail repose sur l’avis d’un médecin expert et sur l’analyse du contexte professionnel.
3. Le congé longue maladie : cadre juridique
3.1 Qu’est-ce qu’un congé longue maladie ?
Le CLM est prévu par le statut général des fonctionnaires (loi n° 84-16 pour la fonction publique d'État, loi n° 84-53 pour la territoriale, loi n° 86-33 pour l’hospitalière). Il est accordé pour une maladie grave, invalidante ou nécessitant un traitement et des soins prolongés. Sa durée maximale est de trois ans.
3.2 Conditions d’octroi
Le CLM est accordé :
- Sur demande de l’agent,
- Sur avis du médecin traitant,
- Après avis du comité médical compétent.
Le burn-out, à partir du moment où il génère une dépression ou un trouble anxieux sévère, peut justifier un CLM.
3.3 Rémunération pendant le CLM
Le fonctionnaire perçoit :
- 100 % de son traitement indiciaire les 12 premiers mois,
- Puis 50 % pour les deux années suivantes (ou un complément selon certaines garanties statutaires ou complémentaires).
Les primes et indemnités variables sont souvent exclues du calcul.
4. Procédure de demande et suivi
4.1 La démarche de l’agent
Lorsqu’un agent ressent les signes d’un burn-out, plusieurs étapes sont recommandées :
- Consulter son médecin traitant pour un diagnostic précis.
- Informer son supérieur hiérarchique, de préférence par écrit.
- Déposer une demande de CLM accompagnée des certificats médicaux.
4.2 Le rôle du comité médical
Le comité médical évalue :
- La réalité médicale de l’affection,
- Le caractère grave et invalidant,
- La nécessité d’un arrêt prolongé.
- Il peut demander des expertises supplémentaires.
4.3 Le suivi administratif
L’administration doit :
- Gérer les renouvellements,
- Assurer un suivi régulier,
- Organiser la reprise de l’agent dans de bonnes conditions.
5. Le retour au travail après un CLM pour burn-out
5.1 Visite de reprise et reclassement
Avant toute reprise, le médecin de prévention doit évaluer l’aptitude de l’agent à reprendre son poste ou à être reclassé. Un poste adapté peut être proposé si nécessaire.
5.2 Mesures d’accompagnement
Un retour progressif est souvent préconisé :
- Temps partiel thérapeutique,
- Aménagement du poste,
- Formation ou mobilité interne pour limiter le risque de rechute.
5.3 Risque de rechute
Le risque de rechute est élevé sans mesures correctrices des causes organisationnelles. Une politique de prévention collective est donc essentielle.
6. Prévenir le burn-out dans la fonction publique
6.1 Rôle de l’employeur public
L’administration a une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses agents (art. L4121-1 et suivants du Code du travail, applicables par renvoi).
Cela implique :
- L’évaluation des risques psychosociaux,
- La mise en place de mesures de prévention,
- La formation des encadrants.
6.2 Dispositifs internes
De nombreuses administrations mettent en place :
- Des cellules d’écoute psychologique,
- Des formations sur la gestion du stress,
- Des dispositifs d’alerte pour signaler les situations à risque.
6.3 Dialogue social
Les comités sociaux d’administration (CSA) et les comités hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) jouent un rôle clé pour :
- Identifier les facteurs de risque,
- Suivre les plans d’action,
- Améliorer la qualité de vie au travail.
7. Témoignages et illustrations pratiques
7.1 Témoignage d’un enseignant
« Après plusieurs années à accumuler des heures supplémentaires, à gérer des classes surchargées et à subir une réforme mal préparée, j’ai fini par craquer. Mon médecin a diagnostiqué un épuisement professionnel sévère, justifiant un CLM de six mois. Ce temps m’a permis de me reconstruire, mais le retour reste difficile sans changement réel de mon environnement de travail. »
7.2 Témoignage d’un cadre territorial
« En tant que cadre, je portais la responsabilité d’une réorganisation. La pression de la hiérarchie, les attentes irréalistes et l’absence de soutien m’ont mené à un burn-out. Le CLM a été une bouée de sauvetage, mais le sentiment de culpabilité vis-à-vis de l’équipe persiste. »
8. Aspects contentieux
8.1 Contestation d’un refus de CLM
En cas de refus de CLM, l’agent peut :
- Demander une contre-expertise,
- Saisir la commission de réforme,
- En dernier recours, introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif.
8.2 Responsabilité de l’administration
Si le burn-out résulte d’une faute de l’administration (absence de prévention, surcharge manifeste, harcèlement moral), l’agent peut demander :
- La réparation du préjudice moral,
- L’indemnisation de ses pertes de revenus.
- La jurisprudence administrative tend à admettre de plus en plus ce type de responsabilité.
9. Perspectives et évolutions législatives
9.1 Vers une reconnaissance spécifique ?
Des réflexions sont en cours pour inscrire le burn-out comme maladie professionnelle à part entière, notamment dans certains secteurs comme la santé ou l’enseignement.
9.2 Renforcement de la prévention
Les plans nationaux santé au travail (PST) et la récente réforme de la fonction publique insistent sur :
- La prévention des risques psychosociaux,
- Le développement de la qualité de vie au travail,
- La responsabilisation des managers.
Conclusion
Le burn-out est un phénomène multifactoriel et complexe, révélateur de dysfonctionnements collectifs plus que de failles individuelles. Pour le fonctionnaire, le congé longue maladie constitue une protection légitime et nécessaire pour se reconstruire. Mais au-delà du traitement administratif et médical, la prévention reste la meilleure réponse.
L’administration, en tant qu’employeur responsable, doit veiller à créer un environnement de travail sain, équilibré et respectueux des agents. Le dialogue social, la vigilance managériale et le soutien des collègues sont les piliers d’une culture de prévention durable.
Références principales
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique d’État)
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale)
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière)
Code du travail, articles L4121-1 et suivants
Circulaires et guides ministériels sur la gestion des risques psychosociaux.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Accidents et responsabilité médicale
- octobre 2025
- août 2025
- juillet 2025
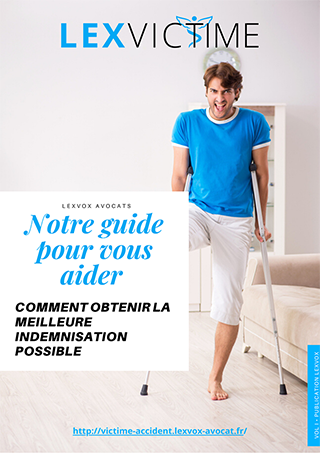
Votre guide gratuit !
Recevez votre guide au format PDF gratuitement par mail


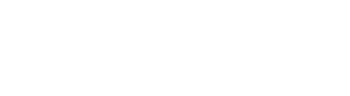
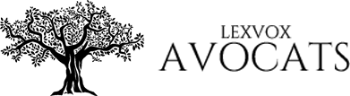




 Devis en ligne
Devis en ligne

